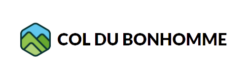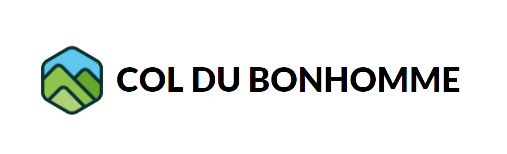Du bush à la boulevard, la veste saharienne a transcendé ses origines pour devenir une véritable icône du style, l’une des pièces les plus polyvalentes qu’un homme puisse posséder.
Il est un peu troublant de constater combien de vêtements masculins emblématiques trouvent leur origine dans le désir humain… de tuer. Ce n’est un secret pour personne : une grande partie des vêtements les plus portés par les hommes viennent de l’armée. Le caban, le blouson aviateur (A-1, A-2, G-1, MA-1, etc.), le pantalon chino, la parka, la liste est longue.
Mais ce n’est pas si surprenant quand on y pense : les vêtements de combat doivent être pratiques. Ils doivent aider celui qui les porte à survivre sur le terrain. C’est une question de vie ou de mort – et c’est précisément pourquoi les armées américaine et britannique ont conçu au XXe siècle certains des vêtements les plus fonctionnels jamais créés : pour éviter la seconde et prolonger la première.
Mais c’est une autre forme de chasse – celle du gibier en Afrique au début du XXe siècle, qui donna naissance à l’un des vêtements les plus adaptables jamais conçus : la veste saharienne.
Origines
Comme son nom l’indique, la veste saharienne fut pensée pour les safaris dans la brousse africaine. Le terme apparaît pour la première fois au milieu des années 1930, mais ses racines remontent aux uniformes Khaki Drill de l’armée britannique, introduits vers 1900 lors de la Seconde Guerre des Boers.
Ces soldats avaient besoin de vêtements légers, respirants, qui ne les entraveraient pas sous la chaleur. Leurs uniformes, confectionnés en coton kaki, comportaient généralement quatre grandes poches à soufflet, un large col, des épaulettes et une ceinture à la taille.
Ce trio poches/épaulettes/ceinture allait devenir emblématique, une combinaison si efficace qu’elle fut reprise par de nombreux modèles militaires par la suite.
Et on comprend pourquoi : les poches offraient une grande capacité de rangement, le col ouvert favorisait la ventilation, et la ceinture maintenait le tout bien en place, un atout majeur quand on traversait des terrains hostiles.
Lorsqu’elle fit son apparition quelques décennies plus tard, la veste saharienne reprenait ces qualités. On ignore qui créa la première, mais elle descend clairement du Khaki Drill britannique. Certaines versions civiles abandonnèrent les épaulettes pour un look plus raffiné, et remplacèrent la ceinture en cuir par une ceinture de tissu assortie, plus confortable et tout aussi pratique.
Les premiers à l’adopter furent des hommes et femmes aisés d’Europe de l’Ouest, séduits par l’idée de parcourir l’Afrique… et d’agrandir la liste des espèces menacées. Les poches spacieuses accueillaient munitions, couteaux, jumelles, cartes, chapeaux pliables à larges bords, et bien sûr, quelques cigares.
Les icônes du style saharien
Ernest Hemingway fut l’un des premiers grands ambassadeurs de la saharienne. Dès 1933, il la portait lors de ses expéditions africaines, exhibant fièrement son allure robuste sur les photos de chasse. Ses vestes provenaient d’Abercrombie & Fitch – qui, loin de l’image aseptisée qu’on lui connaît aujourd’hui, était alors un tailleur d’élite spécialisé dans les vêtements de sport et de voyage.
Une publicité de 1939 vantait sa saharienne comme étant « confectionnée dans un coton anglais importé, traité pour résister à la pluie, pratiquement indéchirable, doux et souple, à la finition lisse et légèrement suédée, idéale pour l’été, en teinte sable kaki. »
Mais c’est à Hollywood, dans les années 1940 et 1950, que la saharienne connut la gloire. Les réalisateurs, séduits par son allure virile et aventurière, en firent l’uniforme de leurs stars : Douglas Fairbanks Jr dans Safari (1940), Gregory Peck dans Les Neiges du Kilimandjaro (1952), et Clark Gable dans Mogambo (1953).
Puis, en 1968, Yves Saint Laurent l’éleva au rang de mythe avec sa collection inspirée de l’Afrique. Il habilla ses muses Betty Catroux et Loulou de La Falaise de ses sahariennes sensuelles, prouvant qu’un vêtement né dans la poussière pouvait devenir synonyme de glamour.
Deux autres figures restent indissociables de la saharienne : le prince Charles, impeccablement décontracté dans ses modèles patinés, et Sir Roger Moore, véritable roi du genre, qui la porta dans cinq films de James Bond ainsi que dans The Persuaders et The Saint. S’il vous faut une référence de style saharien, inutile de chercher plus loin.
La saharienne aujourd’hui
Malgré son passé colonial et militaire, la saharienne est aujourd’hui plus pertinente que jamais. Elle a quitté la savane pour les rues, prouvant qu’un design utilitaire peut aussi être élégant.
Private White V.C. incarne bien cet équilibre entre fonctionnalité et raffinement. Son directeur artistique Nick Ashley confiait :
« La saharienne sera toujours stylée parce qu’elle est pratique. Des tissus naturels robustes, des couleurs terreuses, plein de poches… Celui qui la porte aura toujours tout sous la main. C’est ça, le vrai cool. »
Chez Anderson & Sheppard, tailleur attitré du prince Charles, on la réinvente sous le nom de Travel Jacket, dotée de 15 poches et taillée pour le mouvement. « Le tissu est simple, solide et s’adapte à tous les climats », explique Audie Charles, responsable de la maison. « Une saharienne vit mieux quand elle a déjà vécu. Elle est intemporelle. »
De son côté, Bryceland’s & Co, maison tokyoïte, propose une version sur mesure en tissu Solaro, un sergé beige irisé tissé de fils rouges au revers, véritable chef-d’œuvre d’artisanat avec sa demi-ceinture et son pli militaire au dos.
Aujourd’hui, la saharienne est l’une des pièces les plus polyvalentes du vestiaire masculin. Loin d’être réservée aux aventuriers ou aux aristocrates, elle est devenue un essentiel moderne.
Que vous cherchiez une alternative au blazer classique ou une veste légère à enfiler sur un T-shirt blanc et un jean, la saharienne est une option pleine de caractère , et comme le bon vin, elle ne fera que se bonifier avec le temps.